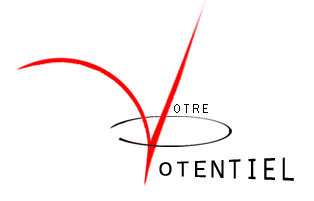Sciences molles : sérieusement ???
Vous ne trouvez pas cette terminologie étrange ? Sciences dures, sciences molles ? Comme si seules les premières pouvaient réellement postuler au titre hautement valorisé en France de sciences ? Et les deuxièmes ne seraient que des produits dérivés qualifiées de « sciences » faute d’avoir trouvé une appellation plus adéquate ? Et quelle conséquence sur notre culture managériale ?
Je trouve pour ma part que cette façon de classifier nous pose quelques questions pertinentes, parmi lesquelles :
- Quelle est la réalité couverte par cette terminologie ? De quoi parle-t-on au fond ?
- D’où vient ce choix sémantique, « dure » versus « molle » ?
- Que dit-elle de notre culture managériale et de ses limitations ?
- Et surtout : comment prendre le recul nécessaire sur la culture en question pour dépasser ces limitations ?
Une question, en revanche, semble trouver toute seule sa réponse : quel type de sciences pratiquait l’inventeur de l’expression « sciences molles » ? A votre avis ?
Déterministe ou probabiliste
Si nous tenons à maintenir une distinction entre deux types de sciences, il convient de mieux les caractériser. Cherchons plus précisément ce qui fait leurs spécificités.

Nous avons d’un côté ces sciences dites « dures » qui décrivent des réalités prédictibles et (globalement) reproductibles à l’identique. Elles englobent une approche que je qualifierai de déterministe, dans la mesure où une cause est supposée avoir toujours la même conséquence observable. Si je lâche une pomme, elle est attirée par la Terre (et réciproquement) et doit chuter. Si j’appuie sur tel interrupteur, la lumière doit s’allumer. Dans le cas contraire, je sors mon ampoule de rechange, au besoin mon tournevis voire mon fer à souder. Mais cette ampoule va finir par s’allumer !

Et nous avons d’un autre côté ces sciences dites « molles ». Elles cherchent notamment à décrire les comportements humains, qu’ils soient individuels ou collectifs. Je parlerai ici d’une approche probabiliste. L’objet de ces sciences est en effet de calculer la probabilité d’apparition d’un résultat donné, cette probabilité n’étant a priori ni certaine ni impossible. Nous sortons donc clairement de cette binarité « certain ou impossible » si chère aux sciences déterministes. Nous nous aventurons dans le monde des pourcentages. Dans ce domaine, rien n’est jamais sûr. Cela n’empêche pas les tenants de ces domaines de pouvoir calculer avec une très grande précision la probabilité d’apparition d’un phénomène. Où est la mollesse ?
Traduction un peu hâtive de soft versus hard
L’origine étymologique de ces expressions est anglo-saxonne, hard science vs soft science. « Dure » est effectivement la traduction la plus courante de « hard ». Mais si « soft » peut effectivement se traduire par « molle », pourquoi ne pas lui avoir préféré « douce », bien plus fréquent ? Nous obtiendrions alors d’un côté des sciences dures et strictes, que nous pourrions distinguer des sciences douces et adaptables.

Mais à cette alternative plus précise et plus respectueuse du sens, nous préférons une traduction dévalorisante à l’égard des sciences humaines.
Est-ce surprenant ?

Pas réellement au pays de René Descartes. Car l’interprétation de l’œuvre de Descartes est passée par là : la dichotomie fait partie de nos réflexes cognitifs. Nous aimons la logique binaire, les oppositions marquées. Il y a ce qui est vrai et ce qui est faux, pas ou peu de place pour les entre-deux.
Si la langue française est décrite comme une langue de diplomatie internationale, c’est sûrement plus pour la finesse de vocabulaire qu’elle offre dans le domaine des ressentis et des opinions que par nos habitudes et capacités à composer ou à trouver des voies médianes.
Nous aimons en effet le déterminisme et pouvoir prévoir le résultat de nos actions. Il n’y a qu’à jeter un œil à notre score national sur l’échelle « évitement de l’incertitude » du modèle de description interculturelle de Geert Hofstede pour s’en convaincre. Nous aimons savoir ce qui va se passer quand nous appuyons sur le bouton. Et ce avant d’appuyer.
Quelles conséquences sur nos comportements ?
Cet attrait pour les sciences déterministes n’est pas sans rapport avec la réputation que nos ingénieurs et nos chercheurs dans ces domaines ont à travers le monde, et cela est une très bonne chose. Il peut être dommage en revanche de ne pas savoir sortir de ces modes de fonctionnement lorsque nous passons au domaine humain (c’est pour accompagner ce genre d’évolution que j’ai développé une approche particulièrement ciblée sur les publics de culture technique ou scientifique que vous pourrez découvrir ici). Conséquences de ces modes de fonctionnement ? Des comportements réflexes qui ne sont pas forcément les plus adaptés.
Quelques exemples de comportements inadaptés
- Considérer que comprendre l’origine d’un problème est un passage obligé de sa résolution en est un des signes. Si nous nous limitons au champ de la technologie, ce principe est tout à fait recevable. Je me rappelle une de mes toutes premières leçons de troubleshooting : « Tu ne peux pas considérer avoir résolu un bug si tu n’en as pas compris la cause première et profonde. » S’agissant du design d’ordinateur, l’idée était parfaitement valide. Mais nous ne pouvons pas extrapoler ce principe à la régulation de la relation entre deux personnes, par exemple.
- De la binarité de nos raisonnements découle également un autre découpage : soit j’ai raison, soit j’ai tort. Et si j’ai raison et que tu n’es pas d’accord avec moi, c’est forcément que tu as tort. L’éventualité d’être tous les deux dans le vrai et défendant des positions opposées ? Exclue.
- Du coup, si un manager n’atteint pas les résultats qui lui ont été fixés, il ne peut y avoir que deux explications possibles : soit il est mauvais, soit son équipe est mauvaise. Pas de droit à l’erreur sur les questions humaines. Et si l’équipe est mauvaise, il faut soit la remplacer, soit la faire réparer. En temps que coach, il arrive assez régulièrement que l’on m’adresse un collaborateur jugé « défaillant » comme on renverrait un modèle défectueux se faire réparer à l’atelier. Passer le message auprès du manager qu’une relation se construit à deux, se détériore à deux et donc a priori se répare à deux devient alors assez délicat.
Bon, admettons, et alors ? Que pouvons-nous faire ?
Quelques pistes de réflexion quant à ce que nous pourrions faire pour enrichir nos pratiques managériales :
1. Chercher une solution d’abord, un coupable ou une origine au problème ensuite (voire pas du tout)
Nous tendons culturellement à préférer expliquer les causes d’un problème plutôt que de lui trouver une solution. De même en management, nous cherchons encore souvent la source d’un conflit, d’une difficulté plutôt que de se concentrer sur sa résolution.
2. Accepter notre absence de contrôle de la situation
Ou adopter ce fameux lâcher prise si souvent évoqué. Lâcher prise ne signifiant pas se désintéresser d’une question, mais faire ce que nous avons à faire et accepter l’idée qu’ensuite il se passe ce qui se passe.
3. Renoncer à l’idée d’avoir raison
Dans le champ des relations interpersonnelles, nous sommes beaucoup sur un schéma raison/tort, où en cas de conflit, il y en a forcément un qui a raison et l’autre qui a tort. Discuter devient alors un affrontement au lieu d’un échange.
Juge ou soignant ?
D’une manière plus globale, en termes de culture managériale, nous gagnerions largement à opter pour une posture de soignant plutôt que de juge. Ce sujet me semble suffisamment dense pour mériter un article dédié, mais pour compléter notre propos, dessinons-en les grandes lignes sans attendre :
Le juge s’intéresse avant tout au passé pour attribuer des bons et des mauvais points et ne s’intéresse souvent à l’avenir qu’en tant que variable d’importance secondaire. Il se veut infaillible et n’accepte que très rarement de revenir sur une décision voire d’admettre s’être trompé. Il détermine qui a raison et qui a tort, ce qui transforme les confrontations en comparutions et en champ de bataille.
Le soignant est à l’écoute, il connait et reconnait ses limitations. Il se concentre sur l’amélioration de la situation, préfère une « guérison inexpliquée » à un « décès prédit ». Il ne s’intéresse au passé que comme source d’inspiration (ce qui a aggravé la situation et qu’il vaut mieux éviter à l’avenir, et surtout ce qui a bien fonctionné et qu’il serait intéressant de reproduire ou d’amplifier).
Quel dispositif pour accompagner cette évolution ?
Dans la mesure où il s’agit d’un véritable changement de posture, d’une évolution du cadre de référence, les dispositifs de type coaching sont les plus pertinents.
Une approche orientée formation, où seraient exposés ces différents points, est moins adaptée. Le risque, en particulier avec des praticiens des sciences déterministes, serait de leur faire intégrer intellectuellement ce concept sans pour autant conduire à une modification de leurs comportements (une des caractéristiques de ces publics, telles que je les expose ici). Je parle de risque car cela serait rater sa cible (le but étant de faire évoluer le comportement managérial, pas uniquement de nourrir intellectuellement). Et d’autre part, cela pourrait même nuire à une évolution future. Les participants pourraient en effet être convaincus d’avoir intégré ce point (puisqu’ils en ont compris les mécanismes) et ne plus s’y investir.
Coaching individuel ou coaching d’équipe ? Cela dépend essentiellement de la situation que vous souhaitez faire évoluer. Le coaching individuel est particulièrement adapté aux situations de prise de poste ou de hauteur. S’il s’agit de faire évoluer plusieurs personnes, bonne nouvelle : le coaching d’équipe est non seulement plus économique mais également plus efficace. Il permet de jouer sur les différences de perception des participants pour souligner leur caractère subjectif. Il favorise la dimension ludique qui à son tour facilite la remise en cause du cadre de référence. Et il rassure les participants sur le fait qu’ils ne sont pas seuls à affronter cette difficulté.